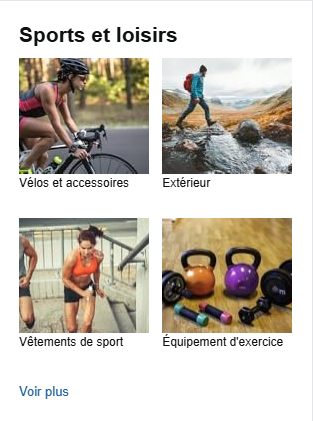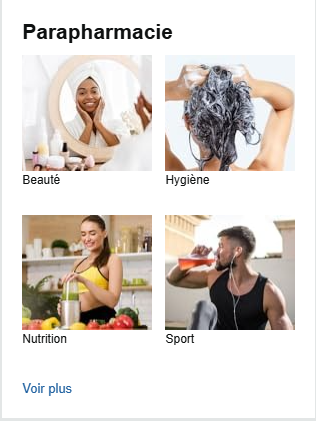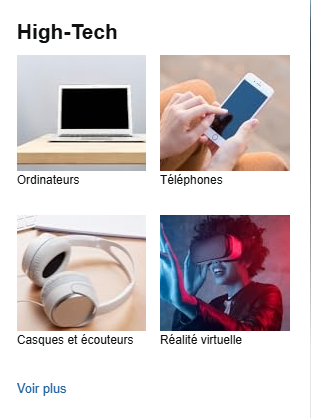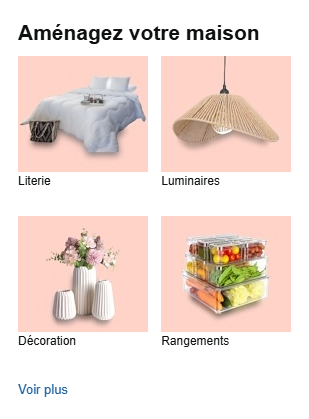Des Protestations d'« influenceurs » en vente pour 8 000 dollars à l'Université de Pennsylvanie, la plus adaptée pour ceux qui veulent s'enrichir

Les réseaux sociaux et l'économie cachée
Les réseaux sociaux ne sont pas seulement un terrain difficile en matière de modération de contenu. Ils représentent également un enjeu économique majeur. Les accords entre influenceurs et entreprises restent souvent secrets, rendant facile la transformation d'une vidéo sur TikTok ou Instagram en publicité déguisée.
En plus des marques, des annonces politiques bien rémunérées circulent. Aux États-Unis, l'organisation démocrate Sixteen Thirty Fund verse 8 000 dollars par mois à plusieurs créateurs de contenu de gauche, atteignant ensemble plus de 13 millions de personnes. Ces messages sont coordonnés par des professionnels, interdisant aux créateurs d'admettre leur rémunération.
Technologie blockchain en Guinée-Bissau
Pour ceux qui pensent que l'État dépense trop en salaires, la situation en Guinée-Bissau est alarmante. En 2020, 84 % du budget de ce pays d'Afrique de l'Ouest était consacré aux salaires des employés publics. Grâce au FMI et à la consultante EY, la Guinée-Bissau a introduit la blockchain pour gérer ces salaires.
Cette technologie permet de détecter facilement les fonctionnaires fictifs. Ainsi, les dépenses en salaires ont chuté en dessous de 50 % du budget, bien que l'objectif de 35 % fixé par l'Union Économique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest reste encore lointain.
Intelligence artificielle et immigration aux États-Unis
L'Intelligence Artificielle (IA) est devenue un élément central de nos pires craintes dystopiques. Des entreprises comme Palantir, fondée par Peter Thiel, alimentent ces inquiétudes en fournissant des services de sécurité aux gouvernements. Cependant, l'IA pose également des défis aux forces de sécurité.
Dominick Skinner, un activiste néerlandais, utilise l'IA pour identifier des agents d'immigration américains, même lorsqu'ils se cachent le visage. Ses programmes peuvent reconnaître une personne avec deux tiers de son visage couvert, révélant ainsi les tensions entre l'État et la cyberrésistance.
Les multinationales indiennes et la durabilité
Il est surprenant de constater que des multinationales indiennes sont désormais plus écologiques que celles de l'UE. Le puissant syndicat allemand IG Metall soutient la vente de la division sidérurgique de Thyssenkrupp à Jindal, une entreprise indienne, car elle utilise une technologie plus verte.
Bien que Jindal ait des avantages, comme des approvisionnements garantis grâce à ses mines en Afrique, cette situation soulève des questions sur la durabilité. La gestion pragmatique et orthodoxe de Jindal pourrait être inacceptable pour une entreprise européenne, mais cela ne pose aucun problème pour une entreprise indienne.
Le libre marché et les subventions
Avec Donald Trump, les subventions aux pays étrangers sont devenues rares, sauf pour ses alliés. Lors de négociations avec le président argentin Javier Milei, Trump a proposé d'acheter de la dette publique argentine, tout en soutenant une vente de soja à la Chine, malgré la guerre commerciale déclarée par Trump.
Cette situation représente un coup dur pour les producteurs de soja américains, qui, après avoir soutenu Trump, se retrouvent maintenant à demander des subventions face à la crise. Les agriculteurs américains, inquiets de l'impact du "socialisme", se retrouvent dans une position délicate.
Universités : savoir ou réseautage ?
Alors que l'année académique débute, il est pertinent de se demander si les grandes universités sont des temples du savoir ou des paradis du réseautage. Selon MarketWatch, la réponse penche vers la seconde option, en comparant la performance académique des universités aux fortunes de leurs anciens élèves.
Les analyses montrent que les universités les plus prestigieuses ne produisent pas nécessairement les anciens élèves les plus riches. Cela est attribué au réseautage, où connaître les bonnes personnes peut faire toute la différence. Pour devenir riche, il pourrait être plus judicieux de choisir l'université Penn plutôt que Princeton.
Conclusion
Les enjeux économiques et technologiques actuels révèlent des dynamiques complexes dans divers domaines. Que ce soit à travers les réseaux sociaux, la blockchain, l'IA ou les stratégies économiques, il est essentiel de rester informé et critique. En fin de compte, ces développements façonnent notre société et notre avenir.