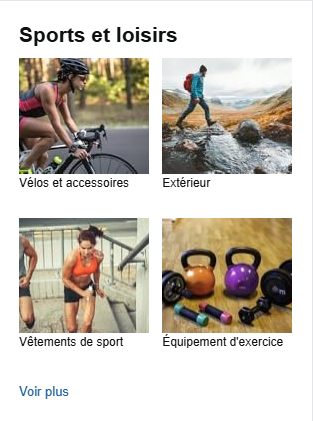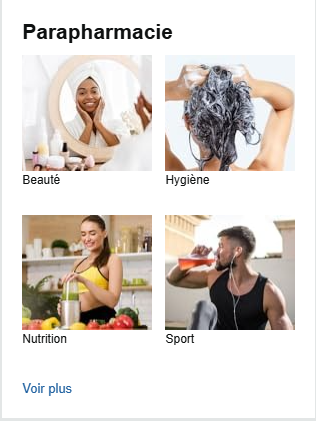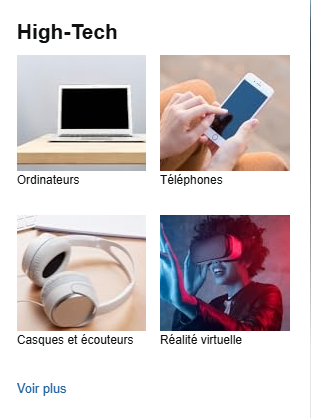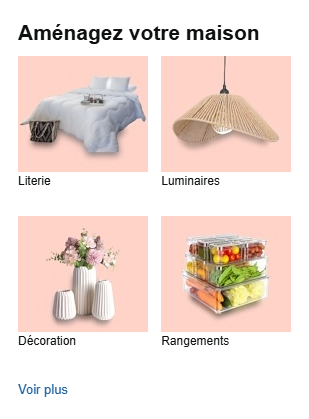Pourquoi les grandes puissances disparaissent-elles ?

Introduction
Les temps difficiles engendrent des hommes forts, qui à leur tour créent de bons temps. Cependant, ces bons temps peuvent mener à la faiblesse, entraînant à nouveau des temps difficiles. Cette citation de Michael Hopf dans sa novel "Les qui restent" nous pousse à réfléchir sur le cycle de l'histoire.
La Nature Cyclique de l'Histoire
Les historiens se sont souvent demandé si l'histoire est linéaire ou cyclique. Depuis l'Antiquité, ils ont analysé les raisons de l'ascension et de la chute des grands empires. Un exemple marquant est celui de Scipion Émilien, qui pleura après avoir incendié Carthage, en se demandant ce qui arriverait à sa propre patrie.
Cette réflexion sur le destin des civilisations a été approfondie par Ibn Khaldoun au XIVe siècle. En observant les ruines romaines en Afrique du Nord, il a écrit la "Muqaddimah", expliquant que la perte de cohésion des empires facilite leur déclin face à des peuples moins avancés.
Les Empires et leur Ouverture
Johan Norberg, dans son ouvrage "Peak Human", examine l'apogée et la décadence de plusieurs empires, comme celui d'Athènes ou de Rome. Selon lui, les empires prospères naissent de l'ouverture à des idées nouvelles, à l'immigration et aux échanges commerciaux. Pericles disait que "notre ville est ouverte au monde", soulignant l'importance de l'accueil des élites étrangères.
Rome, dès son époque républicaine, a su tirer parti de cette diversité pour établir des alliances solides. Ce phénomène s'est également produit à Bagdad sous Harun al-Rachid, où la ville est devenue un centre de prospérité et de cosmopolitisme.
Les Causes de la Chute des Empires
Pourquoi les empires tombent-ils ? Norberg avance que lorsqu'une grande puissance subit un revers, elle a tendance à se replier sur elle-même. Cet isolement accélère son déclin, comme l'illustre la guerre entre Sparte et Athènes qui a conduit à la décadence d'Athènes.
Le même phénomène s'est produit avec l'Empire romain, qui, après avoir souffert de invasions et de plagues, a vu ses frontières se fermer. Cela a permis aux Goths d'entrer pacifiquement, conduisant à la prise de Rome en 410 après J.-C.
Parallèles avec la Situation Actuelle
Bien que Norberg n'examine pas la situation actuelle, il est difficile de ne pas faire de parallèles avec les États-Unis. Après avoir atteint un sommet grâce à l'ouverture, les États-Unis semblent se replier, limitant le commerce et l'immigration. Ce changement pourrait entraîner une fuite des cerveaux sans précédent, alors que de nombreux scientifiques émigrent vers l'Europe.
De plus, des dépenses excessives en intérêts de la dette par rapport à la défense soulèvent des inquiétudes. La cohésion, un élément essentiel selon Ibn Khaldoun, semble également se détériorer aux États-Unis, suscitant des craintes sur leur avenir.
Conclusion
Einstein a dit que "la mesure de l'intelligence est la capacité de changer". L'histoire nous montre que les empires n'ont pas su s'adapter intelligemment. Espérons que les États-Unis ne suivront pas ce chemin. Le futur dépendra de leur capacité à rester ouverts tout en faisant face aux défis contemporains.